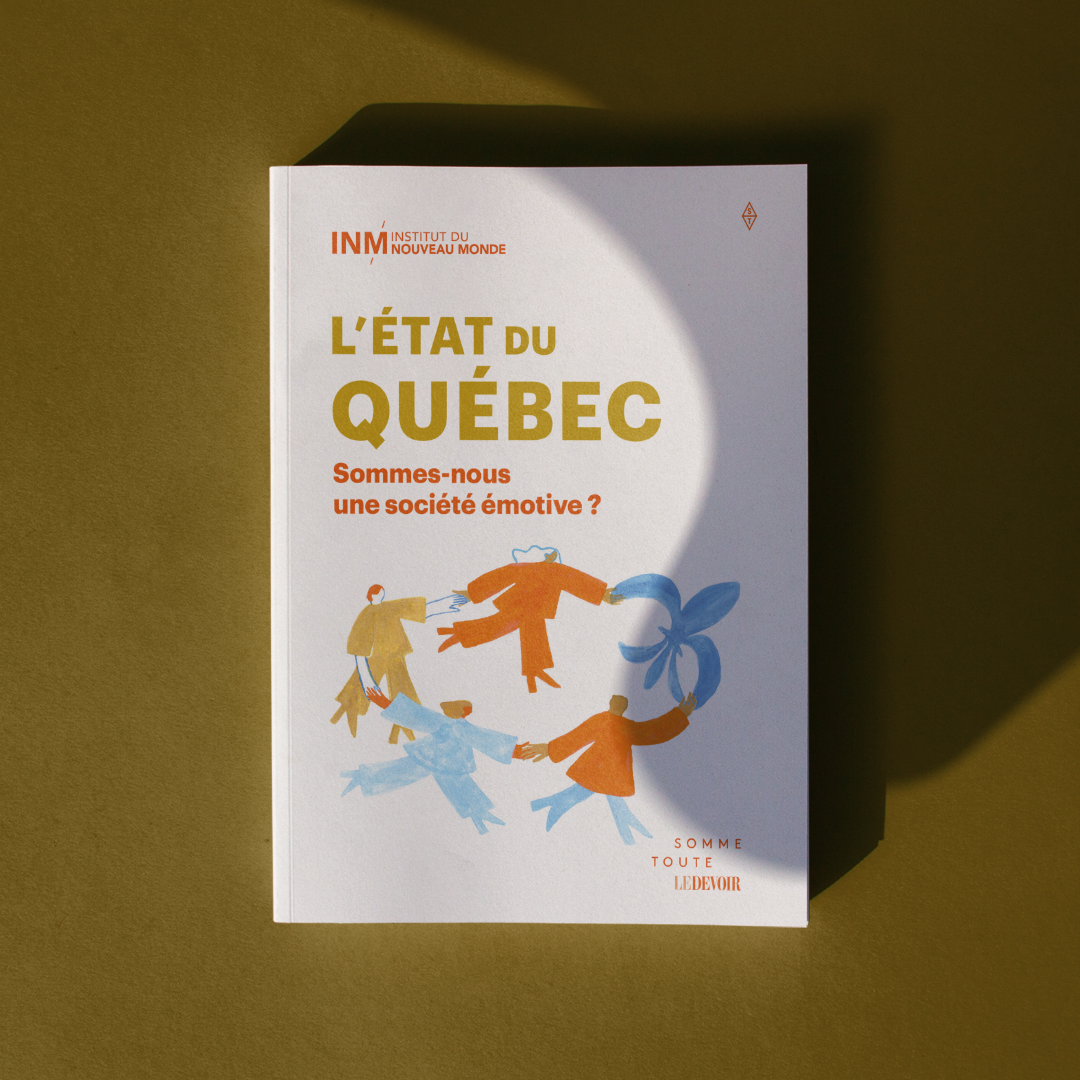L’état du Québec 2025 | Sommes-nous une société émotive?
Susciter le désir de la démocratie

Photo de Manoucheka Lachérie
Malorie Flon
Directrice générale de l’Institut du Nouveau Monde
Ce texte est issu de la publication annuelle de l’INM, L’état du Québec 2025, publiée chez Somme Toute / Le Devoir.
La polarisation, de mieux en mieux documentée1, est l’une des grandes tendances à l’œuvre au Québec comme ailleurs. L’année 2024 a été marquée par un climat tendu, comme en témoignent les défis associés à l’exercice des fonctions des élues et élus municipaux2 et le projet de loi 57 qui a suivi3. Les effets de cette polarisation des opinions sont épuisants, autant pour nos représentantes et représentants politiques qui doivent se construire une carapace pour survivre aux manifestations de haine et d’agressivité dont elles et ils sont trop souvent victimes que pour nos jeunes qui se désintéressent de la politique lorsqu’elle se transforme en attaques partisanes.
Notre mission étant de renforcer la participation à la démocratie, ces questions nous habitent et nous ont donné envie d’explorer dans ce livre la façon dont nos émotions sous-tendent nos actions en société. Car les émotions, s’il faut le rappeler, sont aussi des incitatifs pour passer à l’action. La peur et la colère peuvent faire bouger des montagnes, tout comme le populisme carbure au sentiment d’injustice. Comment donner le goût à toutes et tous de participer dans une société polarisée? Comment faire en sorte que les gens se parlent et se comprennent mieux? Comment rapprocher les idées divergentes et rendre les compromis plus accessibles ou plus fréquents?
Lorsqu’il s’agit d’animer des échanges sur des sujets sensibles, notre travail à l’INM consiste à faire émerger l’intérêt collectif derrière la somme des intérêts individuels, mais aussi à distinguer l’émotion du procès d’intention. L’accueil et la reconnaissance des émotions, pour ce qu’elles sont (des indices, des informations
utiles sur le niveau de confort, d’acceptation ou d’incohérence), peuvent désamorcer bien des situations. En soi, une charge émotive forte n’est ni un manque de respect ni une accusation. Mais lorsque l’émotion se combine à l’une de ces attitudes, alors oui, ça commande un rappel à l’ordre.
Gardons en tête que la « déstructuration de nos systèmes démocratiques» figure parmi les dix perturbations auxquelles les décideuses et décideurs doivent se préparer, puisqu’elles combinent des facteurs de probabilité et de gravité d’impact, selon une récente étude prospective d’Horizons de politiques Canada4. La perturbation la plus probable (dans un horizon de trois à cinq ans) est que les gens ne puissent plus distinguer le vrai du faux. Un plus grand nombre de personnes pourrait vivre dans des réalités distinctes, façonnées par leurs écosystèmes personnalisés d’informations. La compréhension mutuelle deviendra de plus en plus difficile, et la prise de décision publique complexifiée si les institutions ont du mal à communiquer efficacement des messages clés sur l’éducation, la santé publique et les autres domaines d’action gouvernementale.
Pour s’y préparer, peut-être faut-il déplacer notre regard depuis les élections, les sondages qui les gouvernent, la popularité des politiciennes et politiciens vers ce qui se passe entre ces élections, et en particulier vers le soin que l’on porte aux relations humaines.
Susciter le désir et l’appartenance à notre société démocratique est peut-être notre plus grand défi d’équilibrisme contemporain. Cela ne peut passer par autre chose que l’écoute, le dialogue, la lutte contre l’exclusion sociale. Pour cela, il y a des traits psychologiques contre lesquels lutter, tels le réflexe du bannissement et les tendances à la simplification. Mais parallèlement, réapproprions-nous les émotions comme vecteurs de mobilisation, et profitons-en pour générer de l’affect vis-à-vis de la démocratie. Peut-être pouvons-nous même en (re)faire un projet de société à aimer et à désirer?
—
- Justin Ling (2023), Le fossé se creuse: La montée de la polarisation au Canada, Forum des politiques publiques. [https://ppforum.ca/wp-content/uploads/2023/08/LeFoss%C3%A9SeCreuse-FPP-AOUT2023-FRE2.pdf].
- Rosanna Tiranti (2023), «Départs d’élus : une situation alarmante, selon le président de l’UMQ», Radio-Canada. [https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2027968/depart-elus-president-umq-martin-damphousse].
- «Projet de loi no57, Loi édictant la Loi visant à protéger les élus municipaux et à favoriser l’exercice sans entraves de leurs fonctions et modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal » (2024), Assemblée nationale du Québec. [https://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-57-43-1.html].
- Horizons de politiques Canada (2024), « Perturbations à l’horizon. Rapport 2024», Gouvernement du Canada. [https://horizons.service.canada.ca/en/2024/disruptions/index.shtml].