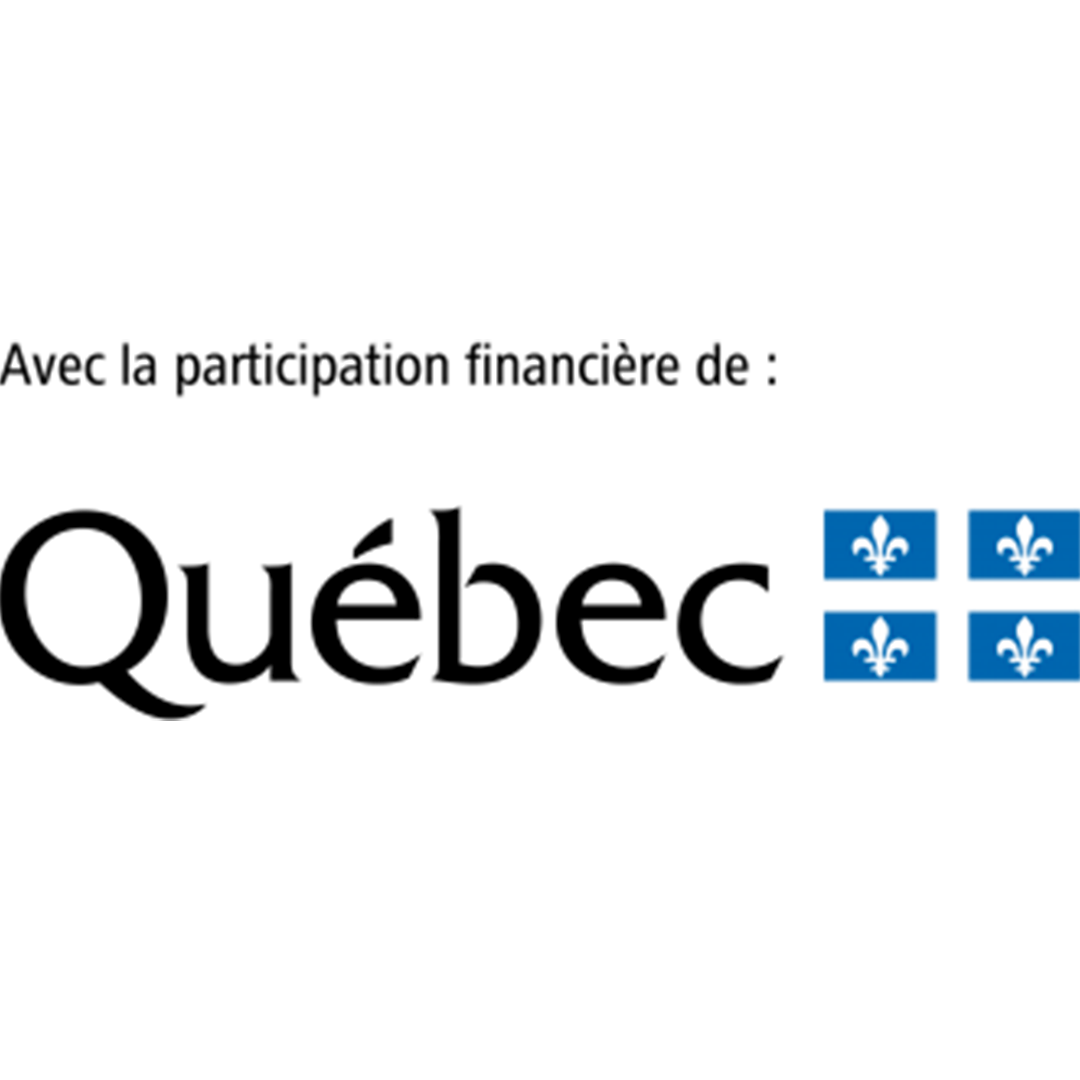Horaire de la webdiffusion
Samedi 29 novembre : 10h à 12h
Dimanche 30 novembre : 13h à 14h15
Lieu
Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)
Coûts
L’inscription, de même que les dîners et les pauses-café, sont offerts gratuitement.
L’hébergement et les déplacements sont à la charge des participant·es.
Horaire
JOUR 1 – SAMEDI
9 h 00 – Accueil des personnes participantes
10 h 00 – Bloc 1 : Ouverture
10 h 30 – Bloc 2 : Présentation de la démarche de consultation et des résultats
12 h 00 – Dîner
13 h 00 – Bloc 3 : Approfondissement des thématiques en sous-groupe
15 h 00 – Pause
15 h 15 – Bloc 4 : Brainstorm collaboratif
16 h 45 – Bloc 5 : Clôture et mot de la fin
JOUR 2 – DIMANCHE
9 h 00 – Bloc 6 : Ouverture (en sous-groupes)
9 h 15 – Bloc 7 : Exercice de priorisation
10 h 30 – Pause
10 h 45 – Bloc 8 : Élaboration des recommandations
12 h 00 – Dîner
13 h 00 – Bloc 9 : Présentation des résultats (plénière)
14 h 15 – Bloc 10 : Clôture et mot de la fin
Contexte
Comment la pratique sage-femme peut-elle mieux participer à une meilleure réponse aux besoins croissants
en périnatalité et en santé sexuelle? La profession sage-femme existe depuis maintenant plus de 25 ans au Québec. Ce quart de siècle à accompagner les familles et à jouer un rôle incontournable dans la périnatalité appelle à faire le point!
Au printemps 2025, une démarche de consultation publique a été menée au Québec afin d’évaluer l’évolution de la pratique sage-femme, 25 ans après sa légalisation, et de réfléchir collectivement à son avenir. Soutenue par le ministère de la Santé et des Services sociaux, cette démarche s’inscrivait dans un contexte de transformation importante du réseau, où de nombreuses pistes d’action restent à explorer pour assurer l’accessibilité, l’intégration et le développement durable de la pratique sage-femme. Les consultations ont été pilotées par l’Institut du Nouveau Monde, qui a accueilli avec ouverture et impartialité toutes les observations et propositions reçues lors des activités participatives.
Activités
Création d’un panel citoyen
Auditions de personnes expertes
Rédaction de l’Avis du panel citoyen
Questionnaires en ligne

Les activités de consultation
Le panel citoyen
Un panel citoyen composé de 16 personnes a été formé pour répondre à la question suivante :
« Souhaitons-nous offrir un accès équitable et de qualité aux services de sage-femme? Si oui, comment? Si non, pourquoi? »
Le mandat des membres du panel citoyen consistait à prendre connaissance d’un document d’information et à rencontrer des spécialistes de la pratique sage-femme et de l’accessibilité aux soins de santé au Québec. Le panel a ensuite été accompagné pour délibérer et formuler un avis.
Les membres ont été sélectionnés à la suite d’un appel à candidatures administré par Léger auprès d’un panel Web de 20 000 personnes. 375 candidatures ont été reçues et sélectionnées aléatoirement par l’INM pour former un panel représentatif de la démographie québécoise.
Qu’est-ce qu’un panel citoyen?
Le panel citoyen est un dispositif de démocratie participative dans lequel un groupe de personnes, tirées au sort, formulent des recommandations sur un enjeu de politique publique à l’issue d’un processus d’information et de délibération de quelques jours. Il fait partie des processus plus généralement appelés mini-publics.


Rencontres avec des personnes expertes
Le panel citoyen a rencontré des personnes expertes lors de deux audiences afin d’en apprendre davantage sur l’histoire de la pratique sage-femme au Québec, ses spécificités dans le contexte québécois, les rôles et compétences associés à cette pratique, l’organisation des services, les modèles internationaux, le portrait de l’accès aux services, les freins et inégalités rencontrés par les populations marginalisées et vulnérables, l’accès pour les communautés autochtones, la collaboration interprofessionnelle, ainsi que l’expérience des usagères.
Conclusion du panel citoyen
Les 16 membres du panel sont fier·ères de publier la version finale de l’Avis citoyen sur l’avenir de la pratique sage-femme, un document adopté à l’unanimité. Au terme de leurs délibérations, les membres estiment qu’il faut garantir un accès équitable et de qualité aux services de sages-femmes.
Ils et elles considèrent que la sage-femme devrait être la porte d’entrée des services périnataux pour toutes les femmes du Québec, et qu’elle devrait pouvoir orienter les grossesses à risque vers d’autres professionnelles et professionnels.
Questionnaires en ligne
Partenaires de la démarche
Les États généraux sur la pratique sage-femme sont le fruit de la collaboration de plusieurs partenaires.
Ils composent un comité visant à définir les grandes orientations de la démarche et à mobiliser toutes les actrices et tous les acteurs du milieu :
- Marie-Eve Blanchard pour le Regroupement Naissances Respectées
- Alix-Ann Boucher-Gendron pour l’Association des étudiant·e·s sages-femmes du Québec
- Sophie Desindes pour le Département d’obstétrique-gynécologie du CIUSSS de l’Estrie – CHUS
- Sabrina Fortin pour la Direction santé mère-enfant du ministère de la Santé et des Services sociaux
- Marie-Ève Giroux pour le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal
- Amaili Jetté pour le Regroupement Les sages-femmes du Québec
- Sarah Landry pour le Mouvement pour l’autonomie dans l’enfantement
- Julie Pelletier pour l’Ordre des sages-femmes du Québec
- Marie-Ève St-Laurent pour le Département sage-femme de l’Université du Québec à Trois-Rivières
- Elizabeth Tailly pour Les cheffes des départements cliniques de sage-femmes du Québec
Nous avons également pu compter sur l’implication d’un comité d’expertes qui veillait à la qualité des contenus informatifs produits dans le cadre de cette démarche :
- Caroline Paquet, directrice de Département sage-femme de l’Université du Québec à Trois-Rivières.
- Marielle Mbangha, coordonatrice du Service de référence en périnatalité pour les femmes immigrantes de Québec
- Raymonde Gagnon, professeure au Département sage-femme de l’Université du Québec à Trois-Rivières.
- Karina Daigle, PhD. en santé publique, professeur au Département des sciences infirmières, Université du Québec en Outaouais
- Frédérique Cornellier, conseillère en développement de projets autochtones au Service Mamawi Mikimodan, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
Crédits photos : Samantha Pelletier photographie
À propos de l’INM
L’INM est une organisation indépendante et non partisane qui a pour ambition d’accroître la participation des citoyennes et des citoyens à la vie démocratique. L’action de l’INM a pour effet d’encourager la participation citoyenne et de contribuer au développement des compétences civiques, au renforcement du lien social et à la valorisation des institutions démocratiques. L’équipe de l’INM est animée par la conviction que la participation citoyenne renforce la démocratie.